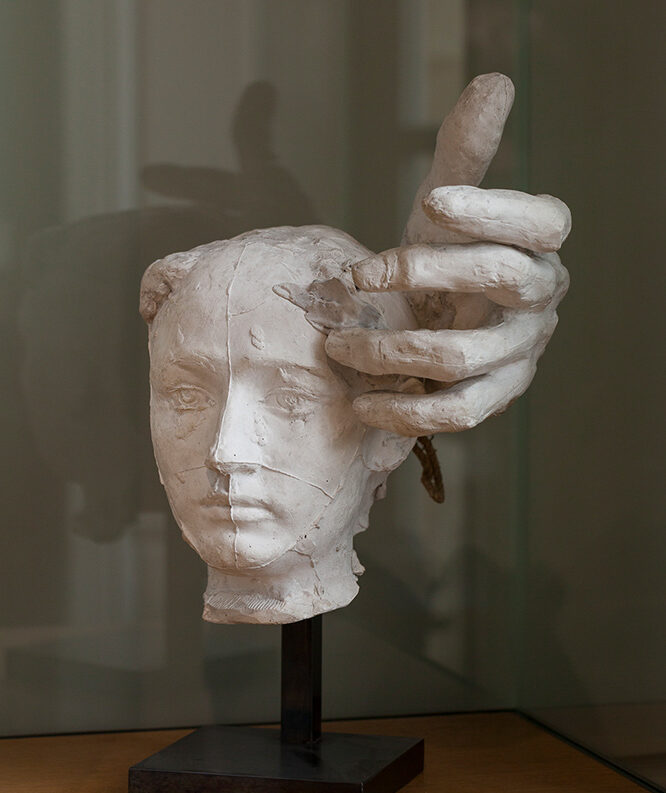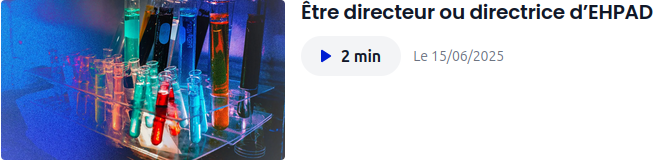Texte de la chronique radio « Ramène ta science », présentée par Daniel Hennequin :
https://www.francebleu.fr/emissions/ramene-ta-science/nord
Bonjour Daniel, aujourd’hui vous nous présentez les travaux d’une thèse de sociologie sur… les directeurs et directrices d’EHPAD ? Pourquoi étudier cela ?
Eh bien, figurez-vous qu’aujourd’hui en France, on ne compte pas moins de 650 000 personnes qui vivent dans un Établissement d’hébergement pour personnes dépendantes, ce qu’on appelle plus souvent EHPAD et qu’on appelait auparavant des maisons de retraite. Et si ce nombre est déjà important, il va encore augmenter avec le vieillissement de la population. Et l’un des enjeux dans les années à venir, c’est de savoir s’il y aura suffisamment de personnels pour prendre soin des futurs résidents d’EHPAD.
Parmi ces personnels, une catégorie est assez peu étudiée : ce sont les directrices et les directeurs d’EHPAD. Et pourtant, il y a un certain nombre de questions qu’on peut se poser, et qui font l’objet d’une thèse de sociologie actuellement menée au CeRIES, le Centre de recherches « Individus, Épreuves, Sociétés » à l’Université de Lille. L’objectif est de mieux connaître ces professionnels et mieux anticiper leurs difficultés, afin de faire en sorte qu’ils soient assez nombreux, compétents et motivés dans les années qui viennent.
Et donc, à l’aide de méthodes d’enquêtes comme le questionnaire et l’entretien, on étudie les profils de directeurs et directrices. Il y a trois parcours identifiés pour entrer dans la profession : on peut embrasser ce métier quand on a la vingtaine, à la sortie d’une école de gestion des établissements médicosociaux, on peut aussi devenir directrice après avoir été infirmière ou cadre de santé, quand on a la trentaine ou la quarantaine. Enfin, on trouve des personnes en reconversion professionnelle, qui ne viennent pas du tout du monde médicosocial, et qui commencent parfois à 50 ans. Quel que soit ce parcours, on trouve dans les témoignages deux raisons fortes de faire ce métier. D’une part, le désir d’exercer un métier utile. D’autre part, ces personnes ont souvent une sensibilité accrue pour les personnes âgées, avec une figure familiale qui fut marquante dans l’enfance.
Alors, vous nous parlez de devenir directrice ou directeur, mais est-ce que des personnes démissionnent une fois en poste ?
Eh bien, il est vrai que, malgré les motivations, on constate des départs de la profession après quelques mois ou quelques années, parfois même quelques années avant la retraite. Ceci s’explique par une accumulation des difficultés : les conflits récurrents, les problèmes de recrutement, les contrôles multiples, l’image dégradée des Ehpad, la solitude de la fonction ou un sentiment d’impuissance devant des situations moralement insupportables. Inversement, ce qui semble faire tenir longtemps en poste certains des directeurs d’Ehpad, c’est qu’ils exercent un « métier passion », comme d’autres métiers du milieu médicosocial. Ce qui aide également, c’est une équipe soudée, qui aide le directeur ou la directrice à réfléchir aux conséquences d’une décision à prendre.
, et dans laquelle le soutien mutuel est constant. Si ces éléments peuvent paraitre évidents, le fait est que ces conditions ne sont pas faciles à obtenir et à maintenir dans le temps. Car la mission principale des directrices et directeurs d’EHPAD, c’est de gérer des problèmes : un manque de temps, des crises qui surviennent, des difficultés de management, et même une remise en question du modèle de l’EHPAD.
Ainsi, on voit bien que l’enjeu n’est pas seulement d’avoir de nouveaux directeurs, mais de faire en sorte qu’ils souhaitent le rester.
Pour en savoir plus
Sociologie des directeurs et directrices d’Ehpad : trois synthèses
Qui sont les directeurs et directrices d’Ehpad ? Un portrait statistique, une analyse d’un référentiel métier et des extraits d’entretiens apporteront de premiers éléments. Ainsi, nous verrons qu’une identité professionnelle se dessine.
Qu’est-ce qui est commun, dans la direction d’Ehpad ? Nous le définirons à travers les normes et le cadre, et à travers les activités pratiques principales que sont l’administratif et la gestion, les relations avec les résidents et les familles, la gestion d’équipe et les partenariats.
Deuxième partie : tenir ensemble les fins et les moyens et tenir soi-même
Comment ces professionnels parviennent-ils à faire tenir ensemble les moyens et les fins ? Alors que logiquement on aurait à chercher comment ils adaptent les moyens en fonction de leurs objectifs, se pose la question de la manière dont ils vont avoir à « retravailler les fins de leur activité en fonction des moyens qui permettent de les éprouver* » ? Qu’est-ce qui les guidera dans ces ajustements, à l’heure de faire des choix ? Et qu’est-ce qui les aidera à « tenir », eux-mêmes, dans cette fonction ?
*Zask, in Dewey, (2010). Le public et ses problèmes. Gallimard. p. 25
Troisième partie : quatre problèmes récurrents et leur gestion
Cette dernière synthèse mettra en lumière une mission centrale des directeurs et directrices d’Ehpad, relevée dans tous les entretiens : la gestion des problèmes.
Quatre problèmes particulièrement importants ont été évoqués de manière récurrente par les directeurs et directrices d’Ehpad enquêtés : les crises, le management, le modèle de l’Ehpad et le temps.
Publication avril 2025
Institut de la longévité, des vieillesses et du vieillissement
FIGUREZ-VOUS… que les directeurs et directrices d’Ehpad connaissent une grande variété de mobilités « hiérarchiques », « horizontales » et « externes »
Christine VALLIN, sociologue, s’intéresse aux parcours des directeurs et directrices d’Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Elle cherche à repérer, puis à analyser, des profils de trajectoires classiques et spécifiques, en croisant les vies personnelle et professionnelle. Son travail repose sur un questionnaire, diffusé depuis mars 2024 principalement via LinkedIn, puis sur 50 entretiens et un groupe participatif. Elle a obtenu 407 réponses au questionnaire : 35 % des répondants ne sont plus dans la profession et l’ancienneté y est relativement faible au regard des statistiques de la profession ; la répartition par sexe et âge est en revanche proche.
À partir de cet échantillon, Christine VALLIN confirme l’existence de trajectoires variées à la tête des Ehpad. Les mobilités « externes » sont les plus représentées parmi ces répondants : 70 % d’entre eux ont travaillé dans un autre domaine que le médicosocial à un moment donné de leur carrière, 33 % dans une fonction de direction. Des mobilités professionnelles « hiérarchiques » sont aussi présentes : 29 % des répondants ont occupé un poste à plus hautes responsabilités que directeur ou directrice d’Ehpad. Les réponses comprennent par ailleurs des mobilités « horizontales » variées : 65 % des répondants ont changé d’Ehpad et 46 % ont connu au moins deux secteurs parmi le public, le privé à but non lucratif et le privé à but lucratif. Enfin une petite partie des répondants n’a connu aucune de ces mobilités (7%) et une autre les a toutes connues (7%).
Si l’hypothèse à l’origine de ce questionnaire tablait sur une diversité de parcours d’accès à la profession, ces réponses montrent que la variété des parcours ne s’arrête pas à l’entrée dans le métier ; elle concerne aussi les trajectoires dans la profession. Les entretiens permettront d’en connaître les motivations.
https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/la-pepiniere/les-figures-du-mois