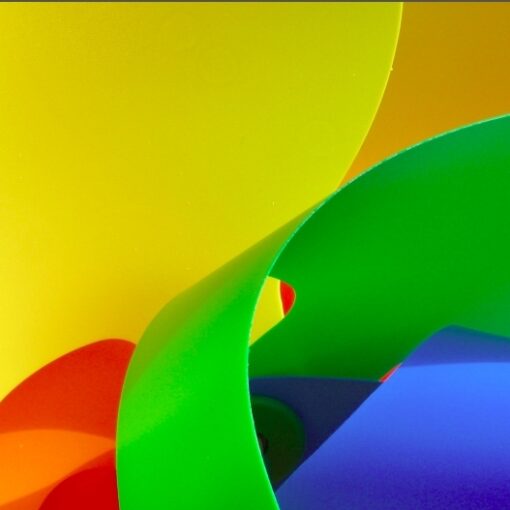Article publié en 2001 dans les Cahiers pédagogiques.
Faire penser les élèves : la discussion philosophique au collège a été pour moi pendant des années, et via un mémoire de maitrise, une occasion d’inciter à réfléchir, par les paroles de chansons par exemple en cours d’éducation musicale, ou lors d’ateliers pour les volontaires.
« J’en sais rien, je ne me suis jamais posé la question ! ». C’est ainsi qu’a débuté une discussion philosophique sur deux heures d’étude dirigée en classe de 5ème 1. Réponse bien surprenante lorsqu’on considère que ceux qui l’ont lancée ont dû passer dans cette école guère moins de huit années de leur vie, réponse qui me valut aussi plus tard la réaction ulcérée de leur ancien professeur d’Education Civique : « On en avait pourtant bien parlé en 6ème ! ». Qui cela « on » ? Peut-être davantage l’enseignant, ses attentes et les convictions qui fondent ses pratiques éducatives quotidiennes ? Le sujet est sensible, ne laisse que difficilement le champ libre à des réponses non institutionnelles, non autorisées. L’écueil a-t-il été évité en discussion philosophique ?
C’est à l’écrit que les élèves ont d’abord réfléchi, pendant une dizaine de minutes. Pour beaucoup, la feuille était bien trop grande : « Ça sert à apprendre des choses, ça sert à notre avenir » ne tient pas beaucoup de place… Pour d’autres cependant, inutile de se forcer à écrire gros, avec parfois plus à dire sur le « Ça ne sert pas » de l’école : « Ça ne sert pas à changer notre comportement et notre façon d’être… à ce que l’on veut faire plus tard… à faire les mêmes choses que chez nous. » et aussi « Ça devrait servir à avoir un bon travail. Ça devrait être plus strict envers les élèves et les profs aussi. » ou encore « Ça ne sert à rien si on n’aime pas apprendre. Ça sert à ne pas être marqué absent. ».
Un besoin
Et le débat a commencé. Les trente élèves assis en cercle ont été invités à demander la parole, partant de ce qu’ils avaient écrit ; classe étonnamment disciplinée, où la règle du jeu démocratique indispensable au bon déroulement fut respectée (j’écoute, quand je souhaite parler, j’attends d’y être autorisé par l’animateur, prof ou élève d’ailleurs). Outre le fait qu’il s’agissait d’une classe « facile », il me semble que cette discussion répondait à un besoin chez eux, arrivant en point d’orgue à la fin de cette année où nous avions réfléchi pour trouver des moyens de mieux vivre ensemble, de mieux réussir scolairement, avec la coopération de l’infirmière, du conseiller d’orientation-psychologue et de l’assistante sociale. Restait à gérer le contenu du débat. Et c’est là qu’en discussion philosophique le rôle de l’animateur se complique. « Certaines matières ne servent à rien ! » : que faire de cette idée ? Inviter l’élève à en dire plus, à préciser ses raisons, sa définition de l’utilité, ou laisser les autres élèves réagir ? Ne pas entrer dans le débat en tout cas (bien que la musique fasse sans doute partie de ces matières inutiles…), rester neutre même lorsque qu’Ahmed, sept de moyenne générale dans ses bons trimestres, avance un tonitruant « Si on ne réussit pas à l’école, c’est qu’on est débile ». Comment faciliter la prise de parole sans tomber dans une juxtaposition d’idées impersonnelles véhiculées par les médias, les copains ou la famille, (qui n’a pas son idée sur l’école ?), en évitant aussi les récits anecdotiques dont les mémoires regorgent, ou même trop intimes, psychologiquement très engageants ? Comment, donc, parvenir à ce qualificatif de « philosophique » dans la discussion ? On n’y était sans doute pas encore dans « Ça sert à avoir des amis… à discuter… à nous distraire… à apprendre des gros mots… à apprendre un bon métier », mais on s’en est peut-être approché dans « ça sert à améliorer le monde en apprenant à y jouer un rôle, par exemple en devenant ingénieur… à connaître le passé et prendre exemple sur quelqu’un… à être capable d’apprendre des choses à ses parents… à accepter les contraintes, se dire que c’est pour plus tard…».
Penser trop vite
La dernière étape s’est faite à nouveau à l’écrit. Les paroles s’étaient-elles envolées ou les interactions avaient-elles permis un enrichissement de leur pensée ? Je me risque à quelques remarques. D’abord, le « J’en sais rien, je ne me suis jamais posé la question ! » a laissé la place à une multitude d’idées (plus de deux cents formulations différentes…) autour de vivre avec les autres, faire, savoir être, apprendre, considérer l’avenir ou l’universel. Tous les élèves se sont exprimés, le plus souvent sans y être sollicités, mais ceux qui l’on fait le plus volontiers ne sont pas toujours les habitués de la prise de parole en cours. Je pense à Armelle qui déclara d’ailleurs avec enthousiasme que « l’école, ça devrait servir à faire des discussions comme celle-ci ». Je pense encore et surtout à Ahmed, ma référence tacite du bien-fondé de la discussion philosophique. J’avais l’impression souvent qu’il ne comprenait pas ce que je disais en cours de musique, qu’il pensait « lentement », souvent loin du cours. Ahmed, moteur de la discussion, acteur dans sa réflexion, capable d’avancer une idée, de l’argumenter, de la réfuter dans la même phrase. Il rejetait mes reformulations jusqu’à ce qu’elles soient conformes à ce qu’il avait dit. Avant, pendant, après la discussion, il avait des questions plein la bouche. Et si, au lieu de penser lentement, il ne pensait pas très (trop) vite ? Suppositions… Quel fut l’impact réel de la discussion sur la réflexion individuelle des élèves ? Des idées nouvelles sont apparues, certes, mais leur origine mériterait des recherches plus approfondies.
« L’école, à quoi ça sert ? » : nulle doute qu’une question comme celle-ci se doive d’être réinterrogée, encore et encore, avant de laisser des traces, avant que Marine n’en vienne à se dire sans qu’on le lui demande: « J’ai des raisons d’aller à l’école ». La discussion philosophique lui laissera-t-elle ces traces ? A voir. A voir surtout lorsqu’elle aura passé huit autres années sur les bancs de cette même école.
Vous voulez soutenir les Cahiers pédagogiques ? Abonnez-vous ici.