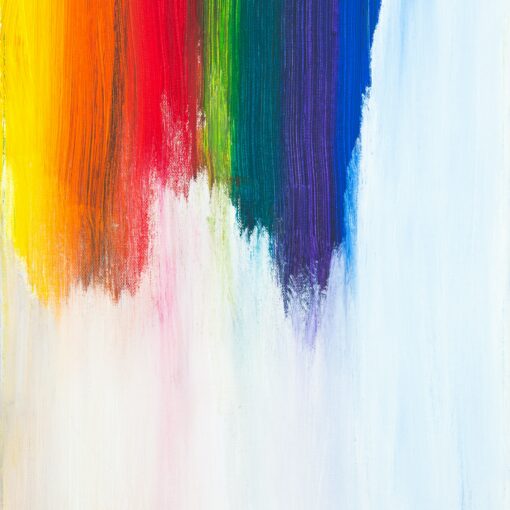Je commence par la question de ce qui compte, ce qui compte vraiment dans ce que l’on vit, ce qui vaut d’y mettre du temps, de l’énergie, de l’inquiétude. Cette question me semble commune dans le cadre du travail, puisque si les différents aspects d’une vie sont complémentaires, ils entrent en concurrence : c’est ce que me disent beaucoup d’enseignants et surtout d’enseignantes, de directeurs et directrices. Beaucoup se demandant : « Est-ce que je fais le bon choix en m’investissant autant dans mon métier ? » C’est aussi une grande question pour moi. Si je veux tenter de décrire comment je vois les choses s’organiser pour moi, spontanément je dis que le travail est au centre de mon système de vie. A quoi ressemble ce centre, qu’est-ce qui l’y a amené et comment expliquer qu’il y reste ?
D’abord, il me semble que c’est une série de causes indépendantes de notre volonté qui nous font emprunter tel chemin plutôt que tel autre, des causes liées à nos déterminismes sociaux, à nos histoires familiales, à certains aspects de personnalité peut-être aussi. Je suis originaire d’un village et toutes les fois que j’y retourne, ce qui me saute aux yeux c’est que les personnes restées là-bas me ressemblent sur beaucoup de plans. Simplement à un moment quelque chose s’est différencié entre elles et moi, peut-être d’abord le goût pour l’école et pour le travail en général, plus ou moins renforcé par nos parents respectifs (l’explicable), puis quelque chose d’insaisissable qui m’a fait « oser l’écart » comme le nomme François Jullien et sortir de ma trajectoire initiale (le mystère).
Mais nos trajectoires sociales, quelles qu’elles soient, me paraissent être des fonds verts par-dessus lesquels l’important se passe. L’important se situerait plus dans le : « Comment vivre ? » que dans le « Quoi vivre ? », que l’on soit restés là où l’on est nés, que l’on ait changé de métier ou gardé le même pendant toute sa carrière. Ce qui compte est alors le miroir tendu des vertus que l’on cite parfois, patience, endurance, générosité, tempérance, exemplarité, courage, indulgence. Ce qui reste, c’est peut-être ce que l’on a fait certes, mais surtout comment on l’a fait. Nos trajectoires morales tiennent la main de nos trajectoires sociales.
Quelle place du métier dans tout cela ? Ce qui m’apparait clairement, c’est que le plus important, le plus précieux, ce sont ceux que j’aime ou que j’ai aimés. Je le reconnais à l’idée que je ne peux pas envisager leur perte sans m’en sentir morcelée, voire détruite. Quand je dis que mon métier est un centre, il ne faudrait pas entendre que c’est le plus important, que c’est ce qui me constitue. Puisque mon métier, aussi intéressant soit-il, aussi prenant soit-il, je peux imaginer « son trou dans l’eau se refermer » et autre chose prendre sa place. Mais c’est un centre pourtant.
Temps, identité et complexité
Si je pense centre quand je pense métier, c’est sans doute parce qu’il a représenté sur vingt-huit ans une continuité (même dans ses discontinuités lorsque j’ai changé de métier) et une stabilité (même lorsque je m’y suis retrouvée déstabilisée). Peut-être à la manière d’une colonne vertébrale, qui a fait tenir tout l’ensemble, particulièrement dans les périodes chahutées. Si je veux définir les particularités de cette colonne vertébrale, j’en garde trois : le rapport au temps, l’identité et la complexité.
Une particularité par rapport au temps d’abord. Depuis que j’ai commencé de travailler, je n’ai plus eu à me soucier de ce que j’allais faire de mon temps. J’ai juste eu à me préoccuper de ce que je n’allais pas en faire, puisque mon travail actuel et ceux qui ont précédé ont toujours été à débordement, ou je les ai rendus ainsi. Cela a évidemment un côté frustrant quand je vois la pile de livres sur ma table de chevet, entends le réveil qui sonne le dimanche, pense aux voyages que je n’ai pas faits. Mais ça m’a presque toujours évité de devoir gérer l’angoisse à l’idée de m’ennuyer. A choisir, je vois bien que je préfère, de très loin, la frustration à l’ennui. Et le travail me préserve de l’ennui.
Ensuite, je garde une particularité par rapport à ce que j’appellerais bien l’identité, constituée des états mentaux successifs, des sensations, des sentiments, des croyances, une fiction naissant de la tendance naturelle à relier des perceptions disparates. Pour Julia de Funès, « croire en cette fiction permet de donner de la cohérence à soi-même et à ce qui nous entoure. […] Cela permet de s’envisager soi-même, de se projeter dans l’avenir, et de construire un monde moral en permettant l’imputation et la responsabilité. » Le monde moral, c’est pour moi le monde qui se régit et se rejoue par rapport aux autres, dans mon bureau quand je reçois un enseignant fragilisé que je sens capable de rudesse, dans une école troublée où le directeur s’est (peut-être) perdu en route, devant des parents en colère qui ne reconnaissent pas être allés trop loin. J’aime bien l’idée du système de causes et conséquences que cela construit, humblement et en évitant les illusions de puissance. J’aime bien l’idée que mon identité ne soit qu’une fiction, mais que ce soit une fiction fertile puisqu’elle me rend responsable, me guide à répondre de. Ce qui donne le sentiment de pouvoir un peu quelque chose, en partenariat avec d’autres personnes, fonctions.
Enfin, en raison de la variété et de la complexité du bain en question, je dirais que j’ai toujours eu de quoi nourrir l’esprit d’énigme, de recherche, pour améliorer la connaissance que j’avais de mes fonctions et les réinventer un peu parfois. Je ne sais pas si cet esprit s’autoalimente quel que soit le bain, et qu’on le porte en soi pour le pire et le meilleur. Je sais juste que pour le moment le mien n’a jamais eu faim. Entre théorie et pratique, j’ai trouvé à la fois à creuser un point en particulier, à descendre donc ; à la fois à faire apparaître de la cohérence, à relier les choses entre elles ; à la fois à modéliser pour gagner en efficacité d’analyse et d’organisation, à travailler alors la méthodologie. Le vertical et l’horizontal du contenu donc, et le contenant.
Mon travail me semble donc avoir joué sur ma trajectoire sociale et morale, et inversement. Et s’il est resté au centre de ma vie, en colonne vertébrale donc, c’est en raison de ces trois caractéristiques en particulier : il structure et emplit mon temps, il me permet de rejouer intensément mon identité avec les autres et il nourrit mon esprit de recherche. Mais cela ne veut pas dire que c’est pour autant la chose la plus importante, celle qui compte le plus. Je sais différencier les deux. Je pense aussi comprendre que ce centre n’est toutefois pas séparé de ce(ux) qui compte(nt) mais que tout cela travaille ensemble, dans le monde moral, l’identité, l’esprit de recherche. S’ils deviennent des adversaires, c’est sans doute dans le domaine du temps, qui reste à partager pour ne pas avoir, un jour, le sentiment de l’avoir perdu.